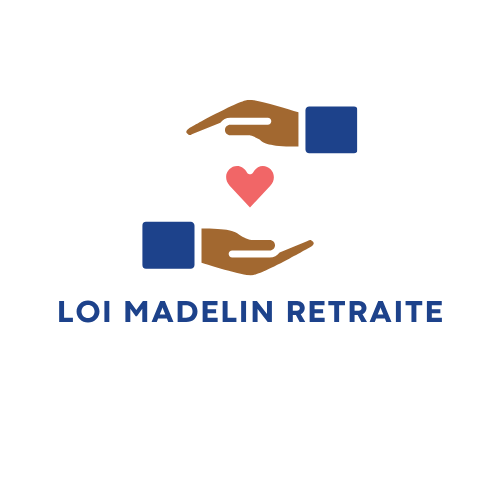Comprendre les Prestations Écologiques Requises (PER) : Le Pivot de l’Agriculture Durable #
Les principes fondateurs des PER agricoles suisses #
L’ancrage des Prestations Écologiques Requises dans le droit suisse remonte à 1993, lorsque la révision de la Constitution fédérale et l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD) ont posé les bases d’une politique agricole conditionnelle. Désormais, toute exploitation souhaitant accéder aux paiements directs doit justifier la mise en œuvre des PER. Ce principe, fondamental pour la durabilité du secteur agricole, soumet le versement des soutiens publics au respect d’exigences strictes dans six domaines majeurs :
- Protection des animaux : application rigoureuse de la législation sur le bien-être animal, incluant la détention, l’alimentation, la gestion des pâturages et des bâtiments d’élevage.
- Bilan de fumure équilibré : gestion rigoureuse des apports et exportations de nutriments, pour limiter les excédents d’azote et de phosphore.
- Surfaces de promotion de la biodiversité : création et entretien d’espaces naturels au service du maintien de la faune et de la flore.
- Assolement régulier : planification raisonnée de la rotation des cultures afin de préserver la fertilité des sols et maîtriser les maladies.
- Protection des sols : mesures de lutte contre l’érosion, le compactage et la perte de matière organique.
- Utilisation ciblée des produits phytosanitaires : limitation des risques pour la santé humaine et les écosystèmes.
L’introduction des PER marque une rupture dans la logique de soutien à l’agriculture : l’État n’accorde plus d’aides inconditionnelles, mais rémunère la réalisation de services écosystémiques mesurables. Ce modèle inspire aujourd’hui d’autres pays européens dans leur recherche d’équilibre entre compétitivité agricole et exigences environnementales.
Parcours d’une exploitation engagée dans la démarche PER #
L’adhésion au cahier des charges PER se traduit par une refonte organisationnelle profonde au sein des fermes. Au quotidien, la conduite d’une exploitation certifiée nécessite une planification fine des tâches et une veille constante sur la conformité des pratiques.
À lire Comment rédiger une lettre pour un rachat partiel d’assurance vie efficacement
- Gestion du troupeau avec contrôles réguliers des conditions d’abri, d’alimentation et des soins vétérinaires.
- Répartition précise des surfaces de promotion de la biodiversité : en 2024, le Domaine de la Touvière à Genève a consacré 11 % de ses terres à des prairies extensives, haies et mares, dépassant l’exigence minimale fixée à 7 %.
- Mise en place de couverts végétaux hivernaux pour limiter l’érosion sur parcelles pentues, comme l’illustre l’exploitation Schmid à Lucerne depuis 2022.
L’adaptation des itinéraires techniques s’accompagne d’un suivi documentaire poussé : registres de traitements, bilans de fumure informatisés, plan de rotation certifié. Les agriculteurs investissent dans le conseil technique et la formation continue, car une non-conformité avérée entraîne le gel immédiat des paiements directs et, parfois, des sanctions financières.
Le bilan de fumure : équilibre entre fertilité et impact environnemental #
La gestion de la fertilisation occupe une place centrale dans le dispositif PER. L’exigence : établir chaque année un bilan de fumure équilibré, c’est-à-dire vérifier que les apports d’azote et de phosphore – issus d’engrais organiques ou minéraux – n’excèdent pas les besoins réels des cultures ni la capacité d’absorption des sols. Cette contrainte vise à endiguer durablement les phénomènes de lessivage, d’eutrophisation des eaux et de pollution de l’air par les émissions d’ammoniac.
- Le logiciel Agrisat permet depuis 2019 la saisie automatisée des flux de nutrients sur des exploitations partenaires en Suisse orientale, réduisant de 18 % les erreurs de calcul et facilitant l’audit environnemental.
- L’exploitation Besson à Vaud a divisé par deux ses achats d’engrais de synthèse grâce à une valorisation accrue du lisier local, tout en atteignant la conformité PER sur cinq années consécutives.
Le contrôle du bilan de fumure s’impose comme un levier économique : il guide la réduction des intrants, limite les pertes et oriente l’innovation vers les engrais de précision ou les couverts améliorants. Nous constatons une baisse de la charge fiscale sur les exploitations respectueuses de cet équilibre.
Surfaces de promotion de la biodiversité : préserver l’écosystème rural #
La création et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) sont au cœur de la stratégie PER. L’enjeu : garantir au minimum 7 % de la surface agricole utile à des zones naturelles dédiées à la faune sauvage, à la flore indigène et à la régulation naturelle des bioagresseurs.
À lire Retrait partiel d’assurance vie : comment optimiser votre contrat et anticiper vos liquidités
- Le Domaine Granges-Neuves à Fribourg a restauré 520 mètres linéaires de haies en 2023, favorisant le retour du hérisson d’Europe et de plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs.
- Les bandes fleuries et les prairies extensives sur les terres du Val-de-Travers abritent maintenant près de 65 espèces végétales, où le papillon azuré a été recensé pour la première fois depuis 1984.
- La ferme Vogel à Zurich a innové en 2022 en implantant 2,5 hectares de mares et de zones humides, permettant la nidification de la sarcelle d’hiver et la reproduction du triton crêté.
Ces espaces multifonctionnels jouent un rôle déterminant dans la stabilisation des populations d’insectes auxiliaires, la pollinisation et la lutte intégrée contre les ravageurs. Leur valeur paysagère contribue à la qualité de vie en milieu rural et à l’attractivité des circuits courts pour les consommateurs en quête de produits authentiques.
Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires : innovations et alternatives #
Le recours aux produits phytosanitaires est soumis à un encadrement rigoureux : seule une utilisation ciblée et raisonnée des substances autorisées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est acceptée. Cette exigence stimule l’essor de l’agriculture intégrée et l’adoption de solutions préventives.
- En 2023, la coopérative Prim’Verger à Neuchâtel a équipé 24 hectares de vergers de stations météo connectées, permettant la modulation précise des interventions fongicides et réduisant de 35 % la quantité annuelle de substances actives appliquées.
- L’exploitation fruitière Montavon dans le Jura a généralisé l’usage de pièges à confusion sexuelle sur 50 hectares contre le carpocapse, éliminant totalement l’emploi d’insecticides conventionnels depuis 2021.
- La ferme Steiner à Thurgovie a initié des essais de biocontrôle à base de nématodes contre les ravageurs du maïs, avec un taux de réussite de 78 % selon les tests conduits entre 2022 et 2024.
Ces pratiques réduisent l’empreinte chimique et renforcent la résilience des agroécosystèmes. Nous constatons que l’innovation technologique, du guidage GPS aux drones de surveillance, constitue un atout majeur pour conjuguer exigences réglementaires et rendement économique.
Les PER agricoles face aux enjeux sociétaux et économiques #
Les PER n’ont pas seulement bouleversé les pratiques agronomiques : elles redéfinissent le paysage économique et sociétal des filières agricoles. L’acceptabilité sociale de la production locale est désormais liée à la transparence et à la capacité des agriculteurs à démontrer leurs efforts pour préserver l’environnement et le bien-être animal.
À lire Complémentaire santé agricole et MSA : comment être bien remboursé ?
- En 2022, la Fédération romande des consommateurs a publié un baromètre révélant que 72 % des ménages accordaient une confiance renforcée aux produits issus d’exploitations engagées dans les PER, en particulier pour les fruits et légumes labellisés Suisse Garantie.
- Les discussions avec le canton de Vaud lors de l’Assemblée cantonale de 2023 illustrent la nécessité de mieux valoriser les surcoûts liés à la transition écologique, afin d’assurer la viabilité des petites exploitations.
- Certains producteurs dénoncent un effet de complexification administrative, pointant une charge documentaire qui s’est accrue de 12 % depuis la digitalisation des audits de conformité, d’après le rapport 2024 de l’Union Suisse des Paysans.
Ce dialogue permanent entre producteurs, consommateurs et pouvoirs publics stimule l’innovation collective. Nous observons une émergence de labels privés et de démarches collectives visant à renforcer la valeur ajoutée des productions respectant, voire dépassant, les exigences PER, ainsi qu’un regain d’intérêt pour les circuits courts et la certification locale.
Vers une agriculture certifiée : défis et perspectives d’évolution des PER #
L’application des PER évolue sans cesse, au gré des avancées scientifiques, des attentes sociales et des négociations internationales. Les agriculteurs suisses font face à des défis multiples : intégrer des nouvelles exigences réglementaires, adapter les outils de gestion technique et répondre à la pression compétitive du marché européen.
- La digitalisation, via la plateforme AgriData, facilite le contrôle du respect des exigences PER : en 2024, 68 % des exploitations vaudoises gèrent leur dossier environnemental de manière dématérialisée, réduisant le temps de traitement administratif de plus de 40 %.
- L’Office fédéral de l’agriculture teste depuis février 2025 un module dédié à la traçabilité des surfaces de compensation écologique, préfigurant l’intégration prochaine d’indicateurs de captation carbone dans la grille des obligations.
- La convergence de la réglementation suisse avec les stratégies européennes (Green Deal) ouvre la voie à une harmonisation partielle, notamment pour les standards de biodiversité, tout en préservant la spécificité du modèle helvétique.
Ainsi, nous sommes convaincus que la réussite du modèle PER dépendra de sa capacité à rester flexible, à intégrer les innovations issues de la recherche et à soutenir économiquement les transitions nécessaires. L’anticipation des évolutions, la formation continue et le dialogue interprofessionnel constituent la clé d’une agriculture suisse résiliente, compétitive et exemplaire, en phase avec les défis du XXIe siècle.
Plan de l'article
- Comprendre les Prestations Écologiques Requises (PER) : Le Pivot de l’Agriculture Durable
- Les principes fondateurs des PER agricoles suisses
- Parcours d’une exploitation engagée dans la démarche PER
- Le bilan de fumure : équilibre entre fertilité et impact environnemental
- Surfaces de promotion de la biodiversité : préserver l’écosystème rural
- Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires : innovations et alternatives
- Les PER agricoles face aux enjeux sociétaux et économiques
- Vers une agriculture certifiée : défis et perspectives d’évolution des PER