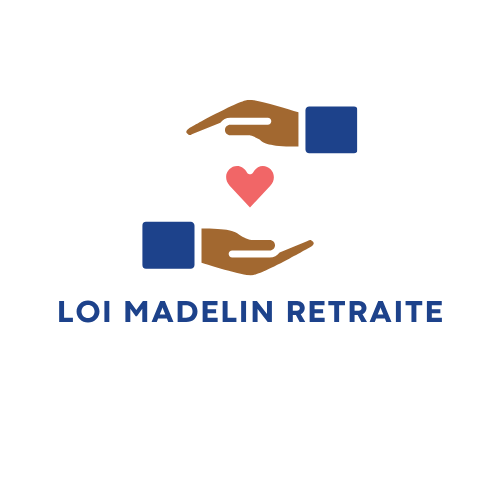Comprendre les Prestations Écologiques Requises (PER) : Le Pivot de l’Agriculture Durable #
Les principes fondateurs des PER agricoles suisses #
L’idée directrice des PER repose sur une conditionnalité stricte de l’aide publique aux critères environnementaux avancés. C’est en 1993, suite à la révision de l’article 104 de la Constitution fédérale, que la Suisse choisit d’ancrer le principe de paiements directs subordonnés au respect de l’environnement. L’Ordonnance sur les paiements directs définit précisément la liste des exigences à respecter, couvrant à la fois la protection des animaux, la biodiversité, le bilan de fumure, l’assolement, la protection des sols et la protection des végétaux. Ce socle réglementaire oblige chaque exploitation à prouver, annuellement, sa conformité pour prétendre au soutien financier de la Confédération.
- Protection des animaux : Application rigoureuse de la loi sur la protection animale, incluant surface minimale par tête, accès extérieur et qualité des aménagements.
- Gestion des fertilisants : Calcul et justification d’un bilan de fumure équilibré pour l’azote comme pour le phosphore, réduisant le risque d’eutrophisation des eaux.
- Promotion de la biodiversité : Mise en place obligatoire de surfaces de promotion de la biodiversité (prairies fleuries, haies, bandes tampons).
- Assolement et rotations : Obligation de diversité culturale pour prévenir l’appauvrissement du sol.
- Protection ciblée des végétaux : Emploi raisonné et traçable des produits phytosanitaires.
Cette architecture législative, saluée pour sa robustesse, s’oppose à un modèle où la productivité primerait sur les équilibres naturels. Nous estimons, à juste titre, que ces principes fondateurs ont contribué à positionner la Suisse en pionnière sur la scène européenne de l’agriculture durable.
Parcours d’une exploitation engagée dans la démarche PER #
S’engager dans la voie de la certification PER bouleverse l’organisation interne d’une ferme. Prenons l’exemple d’une exploitation de 60 hectares dans le canton de Vaud, spécialisée en grandes cultures et production laitière. Depuis son inscription au système PER, cette ferme a revu l’agencement de ses bâtiments pour améliorer le confort animal, introduit une gestion informatique des apports de fertilisants et réaménagé 8% de sa surface en zones de biodiversité.
À lire Comment rédiger une lettre pour un rachat partiel d’assurance vie efficacement
- Aménagement des surfaces : Installation de bandes fleuries, création de mares et plantation de haies afin d’atteindre les 7% réglementaires consacrés à la biodiversité sur l’exploitation.
- Élevage : Adoption du système de stabulation libre, accès permanent à un pâturage et alimentation contrôlée sans OGM, garantissant le respect du bien-être animal.
L’adoption du cahier des charges PER implique des changements profonds : gestion du temps de travail axée sur la surveillance environnementale, collecte systématique de données sur les intrants, planification des rotations culturales pour prévenir l’érosion et la fatigue des sols. Ce fonctionnement, exigeant sur le plan administratif mais bénéfique pour la durabilité, modifie durablement les routines et les relations de la ferme avec son environnement.
Le bilan de fumure : équilibre entre fertilité et impact environnemental #
La gestion des fertilisants, au cœur des PER, se matérialise par le bilan de fumure. Cette obligation vise à garantir un équilibre précis entre les besoins des cultures et les apports en azote et phosphore. Durant la campagne 2022, plusieurs exploitations fribourgeoises ont ainsi recours à des logiciels spécialisés pour calculer :
- Quantité d’azote épandue par rapport à la surface et au type de culture.
- Origine des engrais : séparation des apports organiques (fumier, lisier) et minéraux, avec traçabilité complète.
- Gestion des excédents : limitation stricte des surplus, redistribution vers des parcelles carencées, respect des distances réglementaires par rapport aux cours d’eau.
Ce pilotage agronomique permet non seulement de limiter les fuites de nitrates, mais aussi de préserver la structure du sol. Les exploitants sont, chaque année, contrôlés par les autorités cantonales : quiconque excède les seuils fixés s’expose à une réduction, voire une suppression, des paiements directs. Cette exigence, si elle demande un investissement en formation et matériel, constitue selon nous l’une des avancées les plus notables en faveur de la gestion durable des sols.
Surfaces de promotion de la biodiversité : préserver l’écosystème rural #
Les surfaces de promotion de la biodiversité, pierre angulaire des PER, incarnent l’engagement de l’agriculture vers la préservation des espèces. En 2023, plus de 15% de la surface agricole utile suisse étaient ainsi dédiés à ces aménagements, allant au-delà du seuil réglementaire de 7%. Ces espaces comprennent :
À lire Retrait partiel d’assurance vie : comment optimiser votre contrat et anticiper vos liquidités
- Haies bocagères entre cultures, servant de refuges à l’avifaune et de corridors écologiques.
- Prairies fleuries semi-naturelles, abritant pollinisateurs, papillons et arthropodes essentiels à la chaîne alimentaire.
- Bandes tampons enherbées en bordure de ruisseaux, filtrant les ruissellements de produits phytosanitaires.
- Mares et zones humides restaurées, véritables sanctuaires pour la microfaune aquatique.
On constate une floraison d’initiatives cantonales : dans le canton de Genève, le programme “Prairies Urbaines” accompagne la transformation de surfaces agricoles en refuges de biodiversité, tandis qu’à Fribourg, le projet “Haies vivantes” a permis de planter plus de 40 kilomètres de haies en 2023. L’effet combiné de ces mesures contribue à stabiliser certaines populations d’insectes et d’oiseaux menacés, tout en améliorant la résilience des parcelles face aux aléas climatiques.
Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires : innovations et alternatives #
Le volet “protection des végétaux” des PER impose une utilisation raisonnée et traçable des produits phytosanitaires. Sur le terrain, cela signifie pour les agriculteurs : limiter drastiquement le recours aux substances de synthèse, privilégier la prévention, et investir dans les outils de l’agriculture de précision.
- Biocontrôle : Adoption de nématodes auxiliaires en cultures maraîchères, comme c’est le cas dans la Broye, depuis 2021, pour lutter contre les ravageurs du maïs sans insecticides chimiques.
- Modulation de dose par GPS : Traitement localisé des cultures céréalières, permettant de diminuer de 30% la quantité totale de fongicides appliquée sur une exploitation à Payerne.
- Semis sous couvert et rotations prolongées : Limitation du développement des adventices et baisse des traitements herbicides sur les exploitations céréalières romandes.
L’intégration des nouvelles technologies (capteurs météo connectés, drones pour la détection précoce des foyers de maladies, intelligence artificielle pour cartographier les besoins réels) ouvre la voie à une gestion toujours plus fine des intrants. Nous estimons que ce mouvement vers l’optimisation et la substitution des produits chimiques place la Suisse à la pointe de l’innovation agro-écologique.
Les PER agricoles face aux enjeux sociétaux et économiques #
La généralisation des PER bouscule les équilibres jusque dans les filières et les relations avec les consommateurs. Si la rentabilité de certaines exploitations, notamment maraîchères, s’en trouve parfois fragilisée à court terme en raison des investissements imposés, il apparaît que les labels environnementaux deviennent de puissants leviers de valorisation.
À lire Complémentaire santé agricole et MSA : comment être bien remboursé ?
- Marché du lait suisse : Dès 2024, la laiterie de Gruyère rémunère avec une prime spécifique le lait issu de fermes certifiées PER, valorisant l’image d’un produit « propre ».
- Vente directe : Le nombre de points de vente agricole proposant des produits labellisés PER a augmenté de 20% en deux ans, selon la Fédération Romande des Consommateurs.
Les attentes sociétales, qui placent la durabilité et la traçabilité au cœur des achats, trouvent dans le dispositif PER une réponse crédible et structurante. Toutefois, le poids des démarches administratives, la pression concurrentielle avec des pays à législation moins stricte, et la complexité de concilier rendement, protection de l’environnement et exigences du marché, alimentent un débat persistant. Nous considérons que l’avenir des PER passe par un dialogue renforcé avec les acteurs économiques et une adaptation agile aux évolutions climatiques.
Vers une agriculture certifiée : défis et perspectives d’évolution des PER #
La mise en place des PER n’est pas exempte d’obstacles. Les exploitants pointent les difficultés d’interprétation, la nécessité de maintenir la rentabilité, et la variabilité des contrôles cantonaux. Néanmoins, la dynamique reste résolument tournée vers le progrès :
- Évolution réglementaire : La révision 2025 de l’Ordonnance sur les paiements directs prévoit l’extension des exigences, notamment pour la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Digitalisation du suivi : L’implémentation de plateformes numériques pour la gestion des données environnementales simplifie les contrôles et améliore la transparence.
- Harmonisation européenne : L’accélération de la convergence avec les normes de la PAC (Politique Agricole Commune) de l’Union européenne ouvre la voie à de nouveaux marchés et à une reconnaissance internationale accrue.
En dépit des prérequis élevés et des remises en question structurelles, il apparaît que les PER forment désormais le socle d’une agriculture suisse à haute valeur éthique et environnementale. Nous croyons que la poursuite de cette stratégie, enrichie par l’innovation et l’adaptation réglementaire, consolidera le rôle exemplaire de la Suisse dans la transition agro-écologique européenne.
Plan de l'article
- Comprendre les Prestations Écologiques Requises (PER) : Le Pivot de l’Agriculture Durable
- Les principes fondateurs des PER agricoles suisses
- Parcours d’une exploitation engagée dans la démarche PER
- Le bilan de fumure : équilibre entre fertilité et impact environnemental
- Surfaces de promotion de la biodiversité : préserver l’écosystème rural
- Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires : innovations et alternatives
- Les PER agricoles face aux enjeux sociétaux et économiques
- Vers une agriculture certifiée : défis et perspectives d’évolution des PER